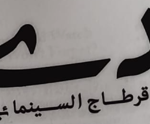Par Kaouther Khelifi
Long-métrage « On the hill » de Belhassen Handous
Le film ouvre sur une ligne de crête, comme toutes les collines en ont une, comme la vie en a une aussi. Sur un flanc, la nature est majestueuse et promise à l’éternité. Sur l’autre, les êtres vaquent à leurs occupations, pour la subsistance. On the hill est un film qui nous élève aux altitudes des cimes, nous rince les yeux à coups de grandeur de champs et nous asperge d’un grand bol d’air frais.
Au milieu de nulle part, une chaumière d’un autre temps. La caméra tombe de haut pour focaliser un temps sur un coq, un temps sur un œil de cheval, une ligne de fourmis par-ci, une meute de chiens par-là, avant de s’incruster à l’intérieur, dans une cuisine où s’accumule tout et rien, dans un décor emprunt de dénuement, relevé par une certaine économie de couleur qui va pourtant tout céder à la lumière. Cela va de soi quand on sait que Belhassen Handous est, avant tout, photographe et artiste visuel, même si l’impression qui se dégage est que la lumière est moins pensée que superbement captée. Il ne la projette pas sur ses sujets, il attend qu’elle s’offre à eux et, par ricochet, à lui.
Nous sommes chez Gisela Bergman, arrivée en Tunisie dans les années 1960 et jamais repartie depuis. Une vie vouée à la nature, à la terre, au grand air, aux lévriers et au chevaux, entre autres.
D’emblée, on s’installe dans cet inévitable antagonisme que nourrit notre condition de citadin et qui nous fait nous interroger sur la distance qui sépare l’humain de sa condition naturelle.
Sur les pas de Gisela Bergman, qui déambule à son rythme à l’intérieur de sa maison comme dans les champs qui l’entourent, nous voilà rappelés à un autre ordre : celui d’habiter le monde tout comme l’habitent les chevaux, chers au cœur de Gisela. Comme l’habitent les lévriers, pour lesquels elle a une passion sans fin. Mais aussi comme l’habitent les rats, elle les a en horreur, mais leur reconnaît le même droit d’exister qu’elle. Ici, on n’apprivoise pas la nature. Ici, on en est un élément parmi d’autres.
Belhassen Handous nous invite à ce cinéma du quotidien qui ne répond, ici, à aucun besoin d’identification. Il n’en est pas à son premier coup d’essai en la matière. Avec Hecho en casa, le réalisateur a déjà eu affaire à la vie de tous les jours, la sienne en l’occurrence, qu’il a saisie dans un décor tout autre, un décor de ville. Mais dans ce décor des Hauts de Hurlevent, on accepte l’inconfort, la frugalité, on se débrouille, on bricole, on se soigne seul quand on tombe malade, on savoure les bains dans les eaux troubles des rivières. Gisela n’est pas à la fleur de l’âge, veuve de son état, mais peut-on jamais dire d’elle qu’elle est seule ? Aucune once d’angoisse ne transperce l’écran pour nous prendre à la gorge. Aucune lamentation ne filtre. Aucun gémissement ne s’entend, même si chaque élément du film semble aller vers sa propre fin.
A l’inverse, les plans qui serrent sur la crinière blanche de l’octogénaire ou la caméra qui se prend dans les plis de sa peau semblent nous rappeler combien les corps remplis de vie vont de bon pied à la mort. Apaisés et presque heureux.
Gisela Bergman est partie en août 2020. Si ses obsèques furent modestes, du moins apportèrent-elles une touche de couleur à son parcours ascétique. A ceci près qu’elle aurait préféré une couronne faite de fleurs des champs.