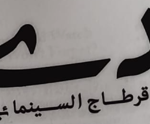Par Anis Kriaâ
Long-métrage « On the hill » de Belhassen Handous
Sur les hauteurs de Ghardimaou (Nord-Ouest de le Tunisie), muni d’un dispositif digne du Cinéma direct, Belhassen Handous s’engage dans une valse visuelle contemplative essentiellement sur la vie –et autant sur la mort- de Gisela Bergman, une ressortissante allemande fondatrice depuis quatre décennies d’un écosystème articulé autour d’une ferme équestre située dans la région.
Tandis que le temps coule d’une manière fluide à l’écart du chaos urbain, ponctué par des appels à la prière provenant de très loin, les images défilent suivant un rythme cyclique qui désarme la linéarité formelle pour autant retenue dans le récit. Telle est la règle de base d’un montage (signé par Alaeddine Slim) qui nous donne à observer une vie, ou plus précisément le soir d’une vie, en diaporama. Autrement, comment une vie, ce qui en reste, et ce qui en déborde, habite ou hante un espace partagé par une pluralité d’êtres.
En parfaite harmonie avec cette configuration, la plupart des plans du film sont fixes. De leur succession se dégage la nette détermination d’un photographe confirmé à brouiller les frontières entre Portrait, Paysage et Nature morte, ainsi qu’à annihiler la hiérarchie de ces genres selon la tradition académique picturale. Les rares panoramiques sont remarquablement pudiques. La caméra n’ose le mouvement qu’à la fin, non pas celle du film, mais celle de la vie de Gisela. Contre toute attente, les deux fins ne coïncident pas. La transition choisie dédramatise sensiblement la mort.
Rétrospectivement, on s’aperçoit que les prémices de ce choix figuraient plus tôt dans le film quand Gisela est insouciante des plaies qui rongent les tissus de sa vielle chair, indifférente au regroupement des fourmis sur son corps de plus en plus sédentaire. Ces fragments s’apparentent à une dissolution quasi organique dans l’écosystème, une sorte de décomposition graduelle et dignement fusionnelle qui va jusqu’à détrôner la mort en tant que fatalité. Du reste, toute la parenthèse funéraire liée à l’enterrement, procédure et rituel à la fois, semble récolter une preuve visuelle de la sophistication d’un processus supposé être naturel. Par contraste, le cheval dont le statut animalier n’est point contesté, bénéficie à la fin (celle du film cette fois-ci) du « privilège » de se dissoudre dans l’écosystème, reposant dans un fossé, couvert de branches et de beaucoup de vermines, dans une scène macabre certes mais telle « une charogne » empreinte d’une certaine esthétique.
Entre les deux fins, l’espace est revisité dans une énième tentative cinématographique de filmer l’absent. Le même dispositif est alors réactivé. Une certaine égalité de l’avant et de l’après est recherchée. Mystiquement, Gisela est retrouvée. L’absence semble ainsi pouvoir définir une existence autant que la présence.