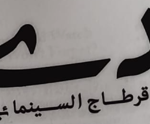Par Sihem Sidaoui
Long-métrage « On the hill » de Belhassen Handous
On the hill “of light” ou comment documenter une forme de vie, en suivant le parcours d’une lumière ? La lumière est l’encre 1du film de Belhassen Handous. Suivre ses apparitions ou ses disparitions, les lieux, les moments de son passage et ses différentes modulations suscite le mystère tout en l’incarnant. Gisela, habitant la colline, l’habitant au sens ontologique, est aussi habitée par ses lumières. Elle traverse le film comme une comète, lumière intense mais dont l’évanescence rapide fait sens. Avant l’apparition du personnage, la lumière est d’abord dans le paysage. Chaque jour a sa nuance de lumière.
Celle-ci donne les traits progressivement à la flore : plans d’ensemble dignes d’un paysage pictural, puis à la faune : des fourmis circulant sur les murs lézardés, annonçant, avant son apparition, les traces du temps sur la peau et le visage de Gisela jusqu’aux chevaux, jeunes et vieillissants, dont l’un, en particulier, est devenu cadavre, après le départ de la gardienne des lieux et de la mémoire. Par moments, prenant la forme de touches discrètes, un morceau de lumière mouvant caresse l’un des pieds du personnage, quand son ami le lave avec beaucoup de soin.
À d’autres moments du film, Gisela est irradiée, devenant être de lumière, déesse de la Colline-Olympe, souvent illuminée comme l’autre visage de cette terre qui semble en dehors de l’espace et du temps. Gisela et ce territoire ne font qu’un. Elle en est une partie comme l’arbre, l’animal ou le minéral. Vu ainsi, nous avons l’impression que le film est complètement en dehors de la vie commune, du vivre ensemble dans la cité, comme si aucune prétention politique ne le traversait : une petite touche, au moment où elle négocie sa retraite avec le gouvernement allemand au téléphone mais sans plus. Ce côté politique, tout aussi discret que le parcours de la lumière, devient plus saillant après l’affirmation de celle-ci comme personnage, accompagné d’une musique liturgique, la veille de la mort de celle dont on documente la vie pastorale. Après cet événement, au cours duquel le film vire vers les limites du fantastique, une dimension pleinement documentaire s’affirme lors de l’enterrement où l’on se dispute le cadavre de la défunte entre Allemands et Tunisiens ; moment où l’on perçoit une ombre s’apparentant à la tête du réalisateur, à moins que ce soit l’ombre de la perche prenant le son ?
La lumière joue avec le spectateur. Le sens est une affaire de hasard, il surgit dans l’imprévu. L’autre lumière qui vient occuper le reste du film est celle du fantôme de Gisela dont le spectateur sera hanté, dès que la caméra commence à filmer l’espace intérieur ou extérieur de la maison : les alentours où elle s’installait. Gisela occupe la mémoire du lieu, comme un fantôme, être de lumière et spectre cinématographique à la fois, gardant les traces de cette forme de vie singulière.
Le spectre cinématographique sauve de l’oubli et archive la vie, y compris dans sa composante la plus invisible : la mort à l’œuvre. Ainsi, les frontières entre cinéma documentaire et cinéma fantastique s’estompent pour rétablir, grâce au cinéma, le mystère du monde dans ce qu’il a de plus quotidien.
- En référence à Jean Cocteau pour qui « le cinéma, c’est l’écriture moderne dont l’encre est la lumière ». ↩︎